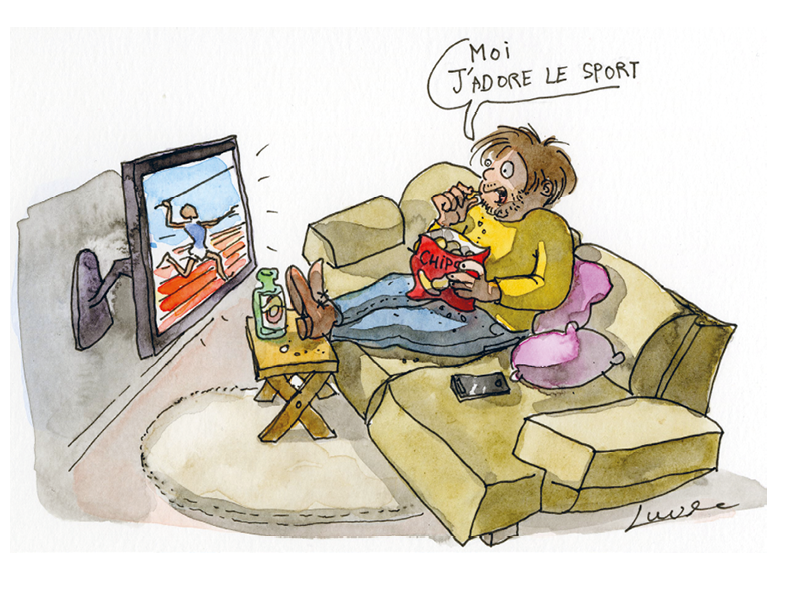Par Christophe Jacon, pasteur à Périgueux
 ……..
……..
Le christianisme a longtemps pris ses distances avec le sport. Dans l’Église primitive, les judéo-chrétiens rejetaient la pratique grecque du sport. Plusieurs éléments expliquent cette réserve. D’abord, les compétitions sportives étaient placées, le plus souvent, sous le patronage des dieux, grecs (Poséidon, par exemple, dans l’isthme de Corinthe) ou romains, et avaient lieu lors de grandes fêtes religieuses. La pratique sportive était donc de fait associé à une pratique idolâtre. Ensuite, la nudité des corps n’était guère compatible avec la pudeur juive, et donc judéo-chrétienne, et avec la tradition de la circoncision. Enfin, le sport que connurent les premiers chrétiens était tout entier tourné vers le combat. Il préparait les hommes à la guerre, développant chez eux la force. Le sport par excellence était donc la lutte, sous diverses formes, et la boxe – ou pugilat (1 Co 9.27). Il faut vaincre, être le plus fort.
Paul, le sportif de Dieu ?
L’apôtre Paul est à la croisée des chemins et des cultures. Il est juif, de tradition grecque (Tarse) et citoyen romain. En tant que juif, « irréprochable selon la loi » (Ga 3), il est raisonnable de penser que Paul fut un critique intransigeant de la pratique sportive grecque. Pourtant, dans ses écrits, il lui fait une place singulière (1 Co 9, Ph 2, Ga 2 ; 3). Mais s’il utilise des métaphores sportives pour parler de la foi en Christ, reprenant sans doute une tradition philosophique stoïcienne (notamment sur l’endurance, la constance ou la maîtrise de soi), il renverse le système de valeurs grec : « Dans sa vision du sport, l’effort sur soi-même l’emporte sur l’émulation et la rivalité des concurrents entre eux (…). Paul ne défend pas une morale de l’émulation, visant à la reconnaissance et aux honneurs publics, mais il défend une morale du dépassement de soi » (Marie-Françoise Baslez, spécialiste du judaïsme hellénisé et du christianisme ancien). La quête de gloire, les rêves de puissance, les récompenses du monde ne devraient plus avoir d’intérêt pour le chrétien. Il est fils de Dieu, assuré de l’amour divin quoi qu’il fasse et, quoi qu’il advienne, certain du dénouement de son histoire. La « couronne » (Philippiens) lui sera donnée, non aux mérites mais par pure grâce.
De Londres…
À partir du second siècle, le christianisme semble avoir été assez conciliant avec la pratique sportive gréco-romaine. La première diatribe est signée Origène (iiie siècle). Il s’en prend de manière virulente à des jeux marqués du sceau de l’idolâtrie et promouvant la violence et la cruauté. Des critiques qui perdureront au fil des siècles. La religion de la Parole faite chair se méfiera du corps, surtout de celui qui s’ébat au jour et à l’heure du rendez-vous dominical… Le regard commence à changer à Londres, à la fin du xixe siècle, avec l’essor des mouvements protestants de jeunesse, et notamment les Young Men’s Christian Association (YMCA). Créée en 1844, cette association essaime rapidement partout dans le monde. Le fondateur, le pasteur Georges Williams, souhaite proposer un hébergement et un lieu sûr et sain où s’épanouir sur le plan spirituel, sportif tout autant que culturel. Le but est d’éviter à ces jeunes, qui se sont déplacés vers les villes lors de la révolution industrielle anglaise, de passer leur temps dans les estaminets ou/et les maisons closes d’alors. Comme le dit Arnaud Baubérot, spécialiste en histoire contemporaine, « en travaillant aux agrès, ou en s’exerçant à la barre asymétrique, en délaissant les boissons alcoolisées et en préservant sa chasteté, le jeune protestant pouvait parcourir la route nouvelle que lui avaient ouverte les organisations de jeunesse pour le mener d’une vie saine à une vie sainte ».
… aux States !
En 1891, le centre YMCA de Springfield, aux États-Unis, va innover. James Naismith, l’éducateur de ce centre, cherche un sport pouvant intéresser de jeunes adeptes du football américain, durant les hivers froids et rigoureux de cette partie des États-Unis. Il cherche un sport collectif, en salle, privilégiant l’habileté, la vivacité et l’agilité plutôt que la force, tout en impliquant un fort engagement physique, mais en évitant la violence : « J’ai créé le basket-ball avec la notion chrétienne de l’amour du prochain, pour que les jeunes puissent y mettre toutes leurs forces et tout leur cœur, tout en gardant constamment le contrôle de leurs réactions, sans les excès qui en feraient un instrument du diable ». Le « basket-ball » naît en 1891 pour répondre à ces objectifs. Il connaît un vif succès et se répand très vite dans tout le réseau YMCA. Il est, en outre, tout de suite adopté (1892) par les jeunes filles américaines, regroupées au sein des Young Women’s Christian Association (YWCA), grâce à Senda Berenson. Cette éducatrice sportive adapte les règles de Naismith, accentuant la socialisation et la coopération : division du terrain en trois zones, deux joueuses en permanence sur chaque zone, élimination du vol du ballon, limitation des dribbles et interdiction pour une joueuse de tenir la balle plus de trois secondes.
Mintonette
Quelques années après, William G. Morgan, professeur d’éducation physique du centre YMCA de Holyoke (Massachussets), va inventer un autre sport de ballon : le volley-ball. Le basket-ball, pensé pour des jeunes, très sportifs, n’est guère adapté pour une population plus âgée. Pour eux, il développe un sport d’intérieur, pour les longues et rudes périodes hivernales : la « mintonette » ! Le premier match est joué le 2 décembre 1895. Les règles étaient différentes de celles du volley que nous connaissons : le nombre de joueurs, par exemple, était illimité, tout comme le nombre de touches de balle avant son renvoi à l’adversaire. En cas d’une erreur de service, un second essai était même permis ! Moins exigeant physiquement que le basket-ball et considéré dès le début comme un sport de loisir, les femmes se l’approprient très vite et l’adoptent partout dans le monde.
Des constantes
Basket-ball, volley-ball, au xixe siècle, mais aussi futsall (football en salle), au xxe siècle, autant de sports inventés par des protestants. Des constantes se dégagent. D’abord, il y a une insistance sur le collectif plutôt que sur l’individuel. Ce qui compte, c’est la coopération, la socialisation. Ensuite, ces sports sont pensés pour éviter la violence. Ce n’est pas une confrontation, de laquelle se dégageraient un vaincu et un vainqueur. Ces sports sont plutôt pensés comme des rencontres. D’ailleurs, il n’y aura de compétition que lorsque ces sports se répandront dans le monde profane. Tant qu’ils restent dans les cercles protestants, il n’y a que des rencontres : des matchs entre deux centres, pour toutes et tous, afin de renforcer la fraternité et la solidarité.