- Accueil
- Actualités
- Culture médias
- Des guerres de religion à la Révolution
Des guerres de religion à la Révolution
Partage
![]()
En Vendée, les traditions communautaires ont beaucoup joué dans le domaine religieux. C’est ce que nous expose Jean-Clément Martin et Philippe Joutard dans cet article, extrait de leur livre Camisards et Vendéens.

Dans le département de la Vendée, les contrastes sont particulièrement visibles. Au sud, dans la zone qui s’étend au pied du Bocage et du Marais breton, les « plainauds » (les habitants de la Plaine) ne sont pas incroyants, mais sans doute plus critiques envers la religion et sûrement moins dépendants du clergé que ne l’étaient les populations de la future zone insurgée.
Un fief protestant

© Domaine public Henri de La Rochejaquelein au combat de Cholet, 17 octobre 1793, peinture de Paul-Émile Boutigny. Musée d’art et d’histoire de Cholet
Par contre dans le Bocage, la piété populaire y est manifestement d’une autre nature, comme en témoignent les confréries du Rosaire, les nombreuses vocations sacerdotales, la pratique plus rituelle, notamment autour des sanctuaires et des pèlerinages.

© Domaine public Le Vendéen, par Julien Le Blant. Musée d’art et d’histoire de Cholet
Cette différence sensible dès la fin du Moyen Âge a été aggravée par les guerres de Religion. Le Poitou devient un des fiefs du protestantisme, gagnant les principales villes de la plaine, comme Fontenay-le-Comte, et les centres artisanaux, suscitant des coups de main et des conflits parfois très violents à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe – le siège de La Rochelle en 1627-1628 par l’armée royale sous le commandement de Louis XIII et du cardinal de Richelieu est le plus connu, mais auparavant, en avril 1622, la prise de l’île de Riez par le roi de France avait sans doute entraîné le massacre de plus de 4 000 protestants. Tout le sud de la Vendée est alors l’occasion d’une véritable croisade de reconquête, comme la Gâtine bressuiraise, faisant du Poitou une terre de mission catholique avant d’être soumis aux dragonnades qui provoquent exils et conversions forcées en grand nombre à la fin du XVIIe siècle. Au siècle suivant, Grignon de Montfort fonde des communautés religieuses en milieu rural destinées à réaffirmer leur attachement au catholicisme.
Des acquis à défendre
La Révolution fait rejouer ces lignes de faille en ayant consacré la reconnaissance du protestantisme dans la société française. En 1791, la liberté de célébration du culte après la liberté de conscience instituée en 1789 avait achevé l’ouverture restreinte, mais réelle, accordée par l’édit de Tolérance de 1787. Pour autant les ralliements ne sont pas systématiques. Les protestants de Moncoutant s’arment dès 1792 pour défendre les acquis de la Révolution, comme ceux de Mouchamps qui sont les premières victimes des Blancs en 1793. Mais la majorité des protestants vendéens reste « neutre » au début de la Révolution alors que les armées « blanches », royalistes, accordent parcimonieusement un espace de liberté aux communautés protestantes locales. Reste que l’armée royale compte beaucoup de catholiques descendants de nouveaux convertis (souvent cette ascendance protestante était même très proche) alors que très peu de protestants ayant témoigné ouvertement leur attachement à la Réforme (notamment par leur participation aux cultes du « Désert ») ne la rejoignent.
Il faut souligner que presque tous les chefs placés à la tête des Blancs sont arrière-petits-fils des gentilshommes ou des bourgeois protestants convertis au moment de la Révocation ou même « religionnaires opiniâtres » dénoncés après 1685 à l’évêque de Luçon et à l’intendant de Poitiers. Comme historien des protestants de la Vendée, le pasteur Romane-Musculus se posait la question : ces nouveaux catholiques, souvent fort pieux, doivent-ils à leur ascendance réformée un esprit de « résistance » alors appliqué à une tout autre cause ? Quelques-uns, fort réalistes, jouissant des biens autrefois confisqués à leurs grands-parents ou leurs grands-oncles émigrés en Hollande ou en Angleterre, ont-ils craint que leurs biens soient restitués aux réformés rentrant en France comme la Révolution l’avait voulu ? L’assimilation catholique avait été forte, et même à peu près totale dans la noblesse.
Des fournisseurs de « brigands »
Cependant, quatre protestants vendéens furent exécutés par les républicains. Le 26 octobre 1793, Louis Coursin, de Saint-Germain-de-Prinçay, et son frère Jean-Louis Coursin, maire de Saint-Hilaire-le-Vouhis le sont à La Rochelle comme fournisseurs des « brigands ». Le terme « brigand » apparaît dans le langage républicain dès les premiers jours du soulèvement de mars 1793. Il peuplera la correspondance des militaires et des autorités constituées tout au long de la guerre, dans le but de discréditer leurs adversaires devenus les « brigands de la Vendée ». C’est un usage courant chez tous les révolutionnaires. Mais c’est pour avoir eu des intelligences avec les insurgés de la Vendée et rejoint les armées vendéennes que Jacques Auguste de La Douespe et Daniel François de La Douespe sont guillotinés en décembre 1793 et janvier 1794. Seuls quelques protestants nobles émigrent et parmi eux quatre gentilshommes se retrouvent dans l’armée des princes ou l’armée de Condé.
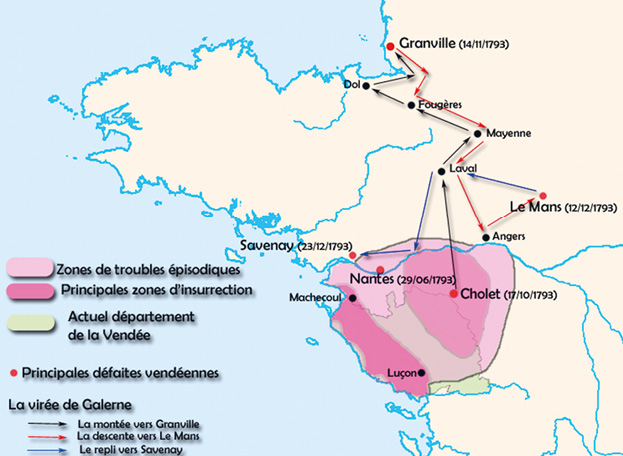
Il faut noter l’incroyable résurrection de l’Église réformée au XVIIIe siècle, avec cette lente et difficile reconquête de la liberté qu’on appelle le temps du Désert. Les communautés se sont restructurées malgré un petit nombre de pasteurs. C’est à partir de cette résurrection que l’Église réformée de France a fait corps au XIXe siècle (malgré le cadre concordataire) et c’est ce qui a donné sa spécificité au protestantisme français (de l’intérieur pour ne pas fâcher les Alsaciens). Pour Jean-Yves Carluer et Didier Poton1, le Réveil a été pour partie facilité par l’arrivée dans l’Ouest de protestants venus des îles britanniques.
Camisards et Vendéens, deux guerres françaises, deux mémoires vivantes
Philippe Joutard – Jean-Clément Martin, Alcide, 144 p., 19,90 €
En matière de guerre civile en France, le XVIIIe siècle a commencé avec les camisards et a fini avec la Vendée. Les deux auteurs, spécialistes reconnus, se sont penchés sur les deux événements en montrant leurs similitudes et leurs différences. Persécution religieuse et incapacité du pouvoir à comprendre les populations concernées dans les deux cas, ainsi qu’une forte mémoire régionale et familiale transmise de génération en génération. L’ouvrage montre bien comment la lecture de ces deux guerres a pu évoluer avec le temps, nous invitant à une réflexion intéressante sur notre rapport à l’histoire et à la politique, civile et religieuse.
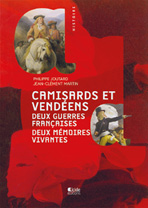
Anne-Marie Balenbois